XVIIIe siècle
-

I. A Word from the General Editor / Mot du Rédacteur en chef – II. Reading and Re-writing : Diderot’s Supplements / Diderot et le supplément – K. TUNSTALL, C. WARMAN, « Foreword / Avant-propos » ; T. BELLEGUIC, « D’un grain l’autre. Sur Diderot et le supplément » ; M. DELON, « Un matérialisme de la note » ; N. FERRAND, « Illustrer Diderot : ses romans face au supplément de la gravure. Le cas de la série d’estampes pour Les bijoux indiscrets » ; J. FOWLER, « Diderot’s “Anxiety of Influence”: Le fils naturel, the Éloge de Richardson and La religieuse » ; C. SETH, « Un géomètre embarrassé dans des toiles d’araignée : Diderot, d’Alembert and a Mathematical Memoir in 1761 » ; E. PAVY-GUILBERT, « Théorie et pratique de la langue : les Salons “suppléments” à la Lettre sur les sourds et muets » ; F. CABANE, « Le philosophe masqué et la “chimère” dans l’Addition aux Pensées philosophiques » ; A. WENGER, « “C’est Horace, qui est un de nos grands médecins, qui l’a dit.” Diderot et le langage médical » ; J.-C. BOURDIN, « L’auto-citation dans Le neveu de Rameau » ; C. DUFLO, « “Cet abîme de ténèbres, pourquoi l’a-t-on creusé ?” : la dynamique matérielle d’après les Observations sur Hemsterhuis » ; R. GOULBOURNE, « Diderot and Horace : From Translation to Imitation » ; I. MOREAU, « Du Voyage de Bougainville au Supplément de Diderot » ; F. VILLEMIN-DE CARNÉ, « Analyse de la réfutation dans Le rêve d’Alembert : la question de l’autorité de Diderot » ; A. STRUGNELL, « Diderot’s Unattributed Contributions to the Histoire des deux Indes : a Question of Style » ; C. VINCENT, « La réflexion morale de l’Essai sur Sénèque : un supplément essentiel au cœur de l’œuvre » ; A. GOODDEN, « Bouquets and the Blind » ; C. WARMAN, « Naigeon, éditeur de Diderot physiologiste » – III. Miscellaneous articles / Miscellanées – J. PARKIN, « Comic Patterns in Le neveu de Rameau » ; F. VIDONNE, « Diderot par Greuze : le dernier souffle, nouvelles observations sur une sanguine du Musée de Montargis » ; J.-C. REBEJKOW, « Le dilemme de Diderot : de la Lettre apologétique de l’abbé Raynal à Monsieur Grimm à l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron » ; L. PIROUX, « What Can the Possessed Possess ? Creativity and Authorship in Diderot’s Paradoxe sur le comédien ».
-

Table des matières
A. BAYLE, M. BOMBART, I. GARNIER, "La connivence, une notion opératoire pour l'analyse littéraire"
I. Mise au point linguistique
C. WIONET, F. H. JIN, "Connivence pile et face: petit parcours historique du mot"
C. KERBRAT-ORECCHIONI, "Construire de la connivence dans les débats présidentiels: avec qui, par quel moyen, dans quel but?"
II. Communications conniventes
M. ROSELLINI, "Faut-il "en abreuver le vulgaire"? Le Roi, le sexe et la connivence"
N. FREIDEL, " Connivences épistolaires: le commerce triangulaire des Sévigné"
J. LECLERC, ""Vous m'entendez fort bien": les stratégies d'une communication connivente dans les parodies burlesques"
J. DORIVAL, "Hélène de Montgeroult (1764-1836): inventer le patrimoine muscial, découvrir l'avenir de la musique"
H. MERLIN-KAJMAN, "Partage par connivence versus partage transitionnel"
III. Fictions de connivence
A. RABATEL, "Analyse pragma-énonciative de la connivence représentée dans les récits"
M. HUCHON, "Connivences labéennes"
L. WAJEMAN, "Connivence érotique et création artistique dans quelques textes et images du XVIe siècle"
M. BERMANN, "Licence et connivence: les dispositifs textuels de complicité avec le lecteur dans les Contes de La Fontaine"
M. FAUGÈRE, "Lecture connivence et construction du groupe dans la fiction galante"
La connivence est une notion qui travaille bien des discours au quotidien: qu'elle soit promue comme le ferment d'une séduction par les concepteurs de nouvelles marques commerciales (qui jouent sur la dimension de complicité implicite qu'elle véhicule) ou qu'elle soit rejetée par les observateurs de la vie politique condamnant la collusion des intérêts privés et publics (à partir du sens étymologique de "complicité morale consistant à fermer les yeux sur la faute de quelqu'un"), elle semble être un outil de description efficace du jeu social. Pour autant, elle n'a que très peu fait l'objet d'une attention spécifique: mobilisée souvent en passant, elle n'a pas été théorisée en tant que notion opératoire dans le domaine des lettres voire des sciences humaines.
Cet intérêt pour ce type de liens, de pratiques et de discours que recouvre l'idée de connivence n'est pas l'apanage du monde contemporain. Un regard jeté vers le passé montre également son importance à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle: dans le champ littéraire en particulier sont mises en oeuvre des formes de connivence spécifiques, entre auteurs, ou entre auteurs et publics, reliées à des conditions historiques précises de production et de publication des oeuvres. C'est cette période, que nous désignons par "l'âge de la connivence", qui est placée au cours de la présente enquête.
Prolongeant les derniers Cahiers du GADGES qui portaient sur des modes de relation entre auteurs et lecteurs dans diverses situations de conflits (Polémiques en tous genres, 2009; Genres et querelles littéraires, 2011; L'art de la conciliation, 2013), l'étude de la connivence explore une des manières dont se manifeste dans l'espace littéraire le regroupement de communautés sociales ou idéologiques.
Plus largement, notre pari est aussi de faire de la connivence un outil utile pour décrire et comprendre à l'époque moderne le rapport des discours et des écrits, voire des oeuvres d'art, à un public ciblé: nous la définissons comme la mise en place volontaire d'un dispositif, le plus souvent textuel, adressé à un ou plusieurs destinataires, et supposant l'existence d'un tiers exclu. A partir de cette réflexion théorique, ce volume offre l'analyse de cas concrets qui rendent perceptible aux lecteurs du XXIe siècle une "intelligence secrète active" qui peut lier les auteurs, entre eux comme à leurs publics.
-
-
-
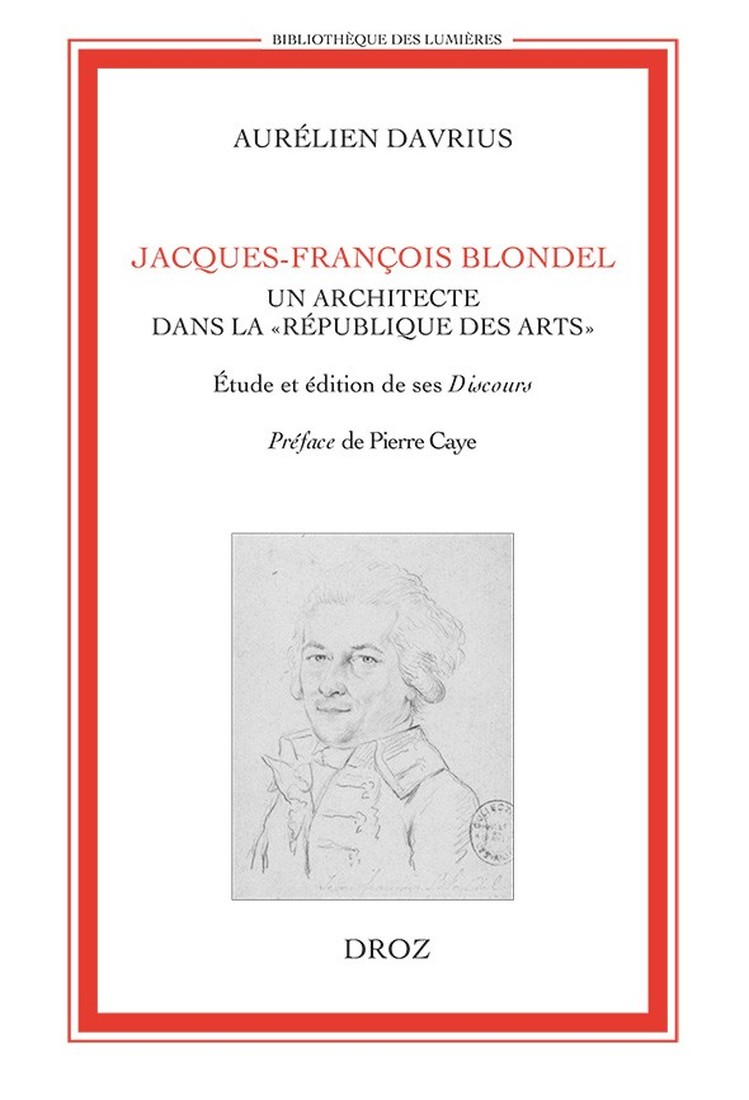
Table des matières
Préface
Introduction
Principes d’édition
Texte 01
Discours sur la manière d’étudier l’architecture, et les arts qui sont relatifs à celui de bâtir. Prononcé par M. Blondel, architecte à Paris, à l’ouverture de son deuxième cours public sur l’architecture,
le 16. Juin 174[7], 1747.
Texte 02
Sélection d’articles de Blondel pour L’Encyclopédie.
Texte 03
« Lettre de M. de Morand, à l’auteur du Mercure, sur l’École des Arts, établie à Paris par M. Blondel, architecte et professeur, rue de la Harpe », La Nouvelle Bigarure, contenant ce qu’il y a de plus intéressant dans le Mercure de France, et de plus curieux dans les autres Journaux et feuilles périodiques etc., août 1753, t. VI, p. 137-142.
Texte 04
Discours sur la nécessité de l’étude de l’Architecture, dans lequel on essaye de prouver, combien il est important pour le progrès des arts, que les hommes en place en acquièrent les connaissances élémentaires; que les artistes en approfondissent la théorie, et que les artisans s’appliquent aux développements du ressort de leur profession, Paris, C.-A. Jombert, 1754, 99 p.
Texte 05
« Lettre XV : Discours sur la nécessité de l’étude de l’Architecture», L’Année Littéraire, 1754, t. V, p. 339-354.
Texte 06
« Discours sur l’Architecture» : notice sur le Discours de Pierre Patte (Paris, Quillau, 1754, 47 p.), L’Année Littéraire, 1754, t. VI, p. 59-66.
Texte 07
Notice sur l’école de Blondel : programmes, prix, réorganisation, Mercure de France, juin 1755, vol. I, p. 198-207.
Texte 08
Notice sur le Cours public d’Architecture élémentaire, L’Année Littéraire, 1755, t. II, p. 206-215.
Texte 09
Notice sur l’Essai sur l’Architecture de Laugier, 1e partie, L’Année Littéraire, 1755, t. II, p. 247-277.
Texte 10
Notice sur l’Essai sur l’Architecture de Laugier, 2e partie, dans L’Année Littéraire, 1755, t. II, p. 322-339.
Texte 11
Lettre de La Font de Saint-Yenne à Marigny, 21 mars 1756.
Texte 12
Lettre de Marigny à La Font de Saint-Yenne, 31 mars 1756.
Texte 13
Discours prononcé à l’Académie royale d’architecture
le [espace blanc] novembre 1756, par Jacques-François Blondel, architecte du roi, dans lequel on essaye de prouver la nécessité de distribuer, tous les ans, dans cette Académie, deux nouvelles médailles, pour deux prix d’émulation, concernant l’art du dessin relatif à l’architecture, 22 novembre 1756.
Texte 14
« Arts utiles : Architecture », Mercure de France, décembre 1757, p. 174-178.
Texte 15
Lettre de M. Blondel à M. Fréron, L’Année Littéraire, 1758, t. II, p. 302-313.
Texte 16
« Lettre XV : Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce », L’Année Littéraire, 1758, t. VII, p. 100-124.
Texte 17
« Lettre VIII : Cours élémentaire d’architecture», L’Année Littéraire, 1758, t. VII, p. 124-137.
Texte 18
Nouveau cours d’architecture par M. Blondel, L’Année Littéraire, 1759, t. VIII, p. 253-262.
Texte 19
Lettre de M. … à M. … sur l’architecture, Mercure de France, juillet 1760, p. 164-171
Texte 20
Réponse à la Lettre de M. … sur l’architecture insérée dans le premier volume de juillet dernier, Mercure de France, novembre 1760, p. 146-151.
Texte 21
Discours sur les avantages que l’Académie retirerait de la publication de ses travaux, dans un ouvrage dont le titre serait : « Histoire de l’Académie royale d’architecture», s. d., sans signature [Julien-David Le Roy], 1762.
Texte 22
Minute de la lettre de Blondel à Marigny, 13 novembre 1762.
Texte 23
Plan des leçons d’architecture servant de préliminaire à l’ouverture des premiers cours, élémentaire et de théorie, que M. Blondel architecte du roi a commencé au Louvre les 15 et 17 novembre 1762, novembre 1762.
Texte 24
Minute de la lettre de Marigny à Blondel, 24 novembre 1762.
Texte 25
Mémoire de Blondel relatif aux élèves de l’Académie, 2 mai 1763.
Texte 26
Mémoire lu avant la leçon publique de l’école royale d’architecture le 1er juin 1763, 1er juin 1763.
Texte 27
Discours de Blondel à l’Académie, 12 novembre 1764.
Texte 28
Mémoire ou observations lu aux élèves de l’Académie royale d’architecture avant la leçon du lundi 9 juin 1766, 9 juin 1766.
Texte 29
Mémoire adressé par Jacques-François Blondel à Monsieur le marquis de Marigny concernant l’École de l’Académie royale d’architecture, 12 octobre 1767.
Texte 30
Réflexions d’un citoyen sur la manière trop arbitraire dont s’exerce l’architecture en France, 1767.
Texte 31
Discours lu publiquement par M. Blondel professeur, aux élèves de l’Académie, le 8 Janvier 1770, et le 16 du même mois dans l’assemblée de l’Académie royale d’architecture, janvier 1770.
Texte 32
Dissertation sur l’utilité de joindre à l’étude de l’architecture celle des sciences et des arts qui lui sont relatifs, suivi d’Observations sur différentes parties de l’architecture, et d’un Ordre des leçons qui continuent de se donner sur l’architecture et sur les sciences qui y sont relatives, par Jacques-François Blondel, architecte, et par les professeurs qui les secondent dans son École des Arts, à Paris, 1772.
Texte 33
Lettre de Marigny à Blondel, 15 mars 1773.
Texte 34
Lettre de Blondel à Marigny, 7 avril 1773.
Texte 35
Extraits du Cours de Jacques-François Blondel.
Texte 36
Extrait des biens inventoriés au domicile de Jacques-François Blondel à sa mort.
Texte 37
Éloge historique de M. Blondel, de l’Académie Royale d’Architecture, & Professeur, Journal des Beaux-Arts et des Sciences, tome premier, mars 1774, p. 559-570.
Texte 38
Critique de l’hôtel d’Uzès de Claude-Nicolas Ledoux par Jacques-François Blondel.
Texte 39
Commentaires sur l’hôtel de Mademoiselle Guimard de Claude-Nicolas Ledoux et sur la nouvelle école de chirurgie de Jacques Gondouin, par Jacques-François Blondel.
Texte 40
Catalogue de la bibliothèque de l’Académie royale d’architecture, par Camus et Blondel, 12 juillet 1763.
Texte 41
Note de l’administration des Bâtiments du Roi à propos de l’achat de livres, 28 octobre 1763.
Texte 42
Liste des livres d’architecture que Blondel souhaite faire acheter par l’Académie, 2 novembre 1763.
Texte 43
Inventaire de la bibliothèque de l’Académie d’architecture en l’an IV, an IV.
Bibliographie
Index nominum
Index des lieu
Au XVIIIe siècle, de nombreux architectes ont publié des traités ou des « Cours » sur leur art. L’un d’eux se distingue par la quantité et la qualité des livres qu’il publie : Jacques-François Blondel (1708/9 – 1774). Auteur majeur de la théorie architecturale, Blondel a su, au cœur des Lumières, redonner une actualité à l’architecture classique, en s’opposant à l’art rocaille qui domine alors. Pour Blondel, l’architecture possède une dimension encyclopédique – il mobilise à la fois les savoirs techniques et les différents arts –, mais aussi sociale – chacun est appelé à y participer. Les écrits de Blondel sont par ailleurs indissociables de son action pédagogique : avec la fondation de son Ecole des Arts, qui se propose de centraliser la diversité des compétences, il opère une véritable révolution pédagogique. Cet ouvrage rassemble les discours, mémoires, articles pour L’Encyclopédie et autres textes de Blondel, dans lesquels le professeur développe ses idées sur le « bon goût » en architecture. Pour la majeure partie inédits, ou jamais réédités depuis le XVIIIe siècle, ces documents renseignent sur les enjeux de l’art de bâtir au siècle des Lumières, ainsi que sur la transmission de la tradition nationale.
-

Au Siècle des Lumières, tandis que l’Europe cultivée parle français, le sud de la France connaît une situation inédite. Le français se répand dans toutes les couches de la population, pas seulement chez les élites. Un partage des langues s’effectue, apparemment selon des critères sociaux, affirmant la prééminence du français, mais en même temps, on continue à parler occitan et à écrire de la littérature dans cette langue. La production poétique est particulièrement abondante (poésie mondaine, comique, satirique…). Au théâtre, on crée de nombreuses pièces et la prose sort des limbes avec un chef d’œuvre, l’Histoira de Jean l’an pres de Jean-Baptiste Fabre. Le succès national de l’opéra en occitan Daphnis et Alcimadure (1754) de Cassanéa de Mondonville ravive ce dynamisme. Les lexicographes s’activent pour consigner la langue tandis que partout, tout au long du siècle, résonnent des noëls, des cantiques et quantité de chansons profanes. Toutes ces créations, jusqu’à ce jour très largement méconnues et jamais mises en relation, illustrent la vitalité d’une langue plus partagée qu’on n'aurait pu le penser.
-
Articles
Olivier Reguin, " Une ancienne mesure d'arpentage dominante en Suisse romande et en Savoie: le jugère carolingien"
Laurent Perrillat, "Pouvoirs seigneuriaux et châteaux en Savoir à la fin du XVIIe siècle, d'après les documents concernant l'aliénation du Domaine ducal"
Françoise Moreil, "Les Orangeois et le Refuge genevois au XVIIIe siècle"
Alain Clavien, "Du bonheur d'être neutre durant les guerres"
Outils et lieux de la recherche
Emmanuelle Chaze, "Un réseau familial international au XVIIIe siècle: pistes de recherche sur la correspondance privée de Jean-André De Luc"
François Jacob, "Jean-Jacques a dit... Un an de lectures rousseauistes"
Jacques Barrelet, "Acquisitions de manuscrits et d'imprimés en 2012"
Jacques Barrelet, "Catalogue des travaux d'étudiants relatifs à l'histoire de Genève"
Collectif, "Chronique bibliographique"
-
Au XVIIIe siècle, la sculpture d’ornement occupait un grand nombre de maîtres et de compagnons. Carl Magnusson lève le voile sur l’organisation du métier et analyse la place des sculpteurs dans la hiérarchie des compétences de leur temps, entre arts mécaniques et arts libéraux. Son terrain de recherche est la Genève des Lumières. A partir de la figure de Jean Jaquet, il explore un milieu professionnel aux vastes ramifications, dont les acteurs viennent des quatre coins de l’Europe, notamment de Paris. La richesse des sources collectées permet de construire une réflexion sur un domaine complexe, encore largement en friche, que l’on sépare trop systématiquement des Beaux-Arts. En attirant l’attention sur le luxe déployé dans les maisons de l’ancienne république, l'étude combat également l’idée profondément enracinée que la Cité de Calvin serait, en vertu de l’austérité prétendument prônée par le réformateur, un désert artistique.
-

En 1783, l’évêque de Limoges Louis-Charles Du Plessis d’Argentré publie un bréviaire à l’usage de son diocèse, avec un propre des saints profondément remanié, revisitant notamment les leçons du deuxième nocturne qui retracent la vie des saints. La singularité de l’« Ecole limousine » repose sur ces abbés érudits, Oroux, Nadaud et Legros, des prêtres du diocèse rompus aux nouvelles méthodes de la critique historique, qui œuvrent aux côtés de Louis-Étienne Rondet et de l’abbé Du Mabaret, cherchant dans la bibliothèque du séminaire les sources permettant d’appuyer le culte des saints sur une réalité historique. Pourtant, l’élaboration des leçons ne se fait pas sans tension : en l’absence de sources, faut-il respecter la tradition, en épurant un peu, ou rejeter tout ce qui ne serait pas assuré ? La publication du bréviaire de 1783 est le résultat de cette tension entre tradition ecclésiastique et histoire, et c’est là son originalité. Le bréviaire est un document essentiel qui montre comment un diocèse comprend et célèbre son histoire religieuse et, par là, permet d’aborder la question de la « tradition ecclésiale », comme l’appelleront les théologiens et les historiens de la liturgie des XIXe et XXe siècles. On suit au fil des pages le processus d’élaboration de ce bréviaire où les rédacteurs se sont employés à ne blesser ni la méthode historique ni la mémoire croyante, ouvrant ainsi une voie originale entre bréviaire « gallican » et bréviaire « romain ».
-

Sommaire
F. OPPERMANN, "Versailles: le dossier chartiste"; V. MAROTEAUX, "Du pavillon de chasse à la résidence capitale: le développement de Versailles à travers les actes royaux (1634-1716)"; A. MARAL, "L'"Estat présant des figures" (1686), première description des sculptures des jardins de Versailles après l'installation de la cour: un document inédit"; V. RICHARD, "La Chambre du roi (XVIIe-XVIIIe siècles): une institution et ses officiers au service quotidien de la majesté"; H. BECQUET, "Les filles de France à Versailles au XVIIIe siècle, entre intégration et exclusion"; G. BOREAU DE ROINCÉ, "Les jardins de Versailles au XVIIIe siècle, théâtre de privilèges et lieu de divertissement"; R. GAILLARD, "Les commissaires-priseurs et les ventes révolutionnaires du mobilier royal"; F. OPPERMANN, "Le remeublement du château de Versailles au XXe siècle, entre action scientifique et manoeuvres politiques" - Mélanges - S. FRAY, "Le privilège d'Urbain II pour Saint-Géraud d'Aurillac (19 avril 1096, JL 5563): un acte falsifié au XIIIe siècle"; V. PONS ALÓS, "Note sur la sainte Epine offerte en 1256 par Louis IX à la cathédrale de Valence (Espagne)" - Bibliographie - Résumés.
F. OPPERMANN, "Versailles: le dossier chartiste"; V. MAROTEAUX, "Du pavillon de chasse à la résidence capitale: le développement de Versailles à travers les actes royaux (1634-1716)"; A. MARAL, "L'"Estat présant des figures" (1686), première description des sculptures des jardins de Versailles après l'installation de la cour: un document inédit"; V. RICHARD, "La Chambre du roi (XVIIe-XVIIIe siècles): une institution et ses officiers au service quotidien de la majesté"; H. BECQUET, "Les filles de France à Versailles au XVIIIe siècle, entre intégration et exclusion"; G. BOREAU DE ROINCÉ, "Les jardins de Versailles au XVIIIe siècle, théâtre de privilèges et lieu de divertissement"; R. GAILLARD, "Les commissaires-priseurs et les ventes révolutionnaires du mobilier royal"; F. OPPERMANN, "Le remeublement du château de Versailles au XXe siècle, entre action scientifique et manoeuvres politiques" - Mélanges - S. FRAY, "Le privilège d'Urbain II pour Saint-Géraud d'Aurillac (19 avril 1096, JL 5563): un acte falsifié au XIIIe siècle"; V. PONS ALÓS, "Note sur la sainte Epine offerte en 1256 par Louis IX à la cathédrale de Valence (Espagne)" - Bibliographie - Résumés.